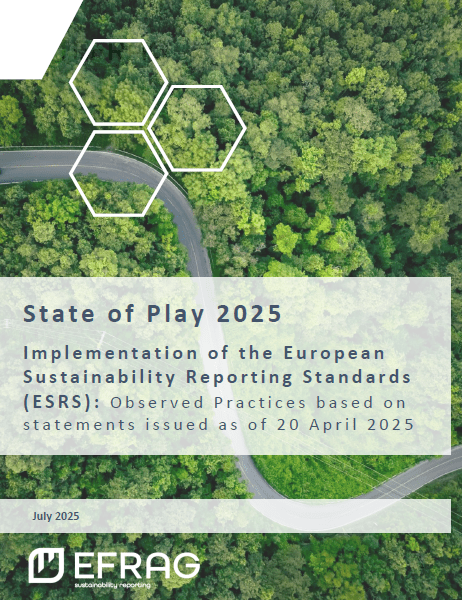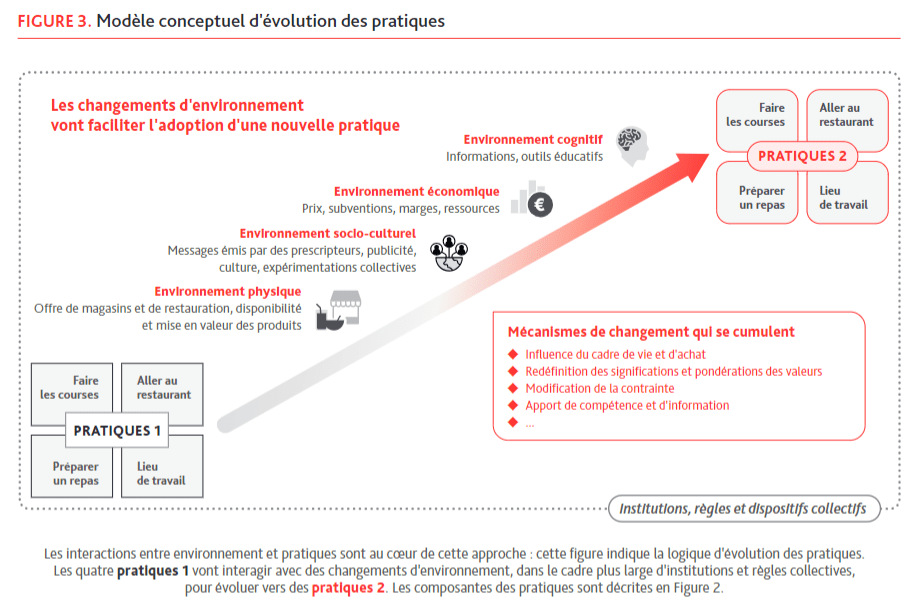| En quelques mots : Le rapport « State of Play 2025 » d’EFRAG essaye de ne pas être un inventaire passif des premières déclarations de durabilité sous le CSRD. Et c’est plutôt réussi, en notant que l’EFRAG a largement utilisé l’aide de l’IA pour effectuer ses analyses. Et c’est le portrait brut d’un système en train de se chercher, entre rigueur normative et tâtonnements méthodologiques, qui est constitué. À travers l’analyse de 656 rapports issus de la première vague d’entreprises soumises aux ESRS, il montre une Europe du reporting ESG encore fragmentée, mais déjà traversée par des dynamiques puissantes. Trois standards – climat, salariés, gouvernance – dominent le paysage, tandis que des enjeux cruciaux comme la biodiversité, les droits humains ou les communautés restent marginalisés, souvent réduits à des mentions décoratives. Une tension importante apparait clairement entre la volonté de structurer un langage commun de la durabilité, et la réalité d’un reporting encore trop déclaratif, trop centré sur les parties prenantes internes, trop peu connecté aux impacts systémiques. Cela souligne aussi les premiers signes d’une maturité émergente : des plans climatiques validés, des cartographies d’impact plus fines, des politiques sociales enfin reliées à des indicateurs concrets. La question lancinante qui subsiste en fin de rapport: le reporting peut-il devenir un levier de transformation, plutôt qu’un exercice de conformité ? Pour cela, il faudra dépasser les silences statistiques, intégrer les voix oubliées, et faire du reporting un outil de gouvernance, d’innovation et de justice. |
Chapitre 1 – Executive Summary : Observations
Une cartographie des premiers pas dans l’ère ESRS
La mise en œuvre du CSRD permet d’entrevoir un panorama des pratiques émergentes en matière de reporting de durabilité, révélant les hésitations des entreprises, leurs audaces, et leurs angles morts dans l’application des normes ESRS. C’est donc ici une plongée dans les entrailles d’un système en gestation, où la rigueur normative côtoie la diversité des interprétations.
Structure et longueur : entre foisonnement et fragmentation
Le premier constat est celui d’une hétérogénéité formelle. Les rapports varient de 25 à 440 pages, avec une moyenne de 115 pages. Cette amplitude traduit moins une différence de maturité qu’une pluralité de styles : certains optent pour une narration dense, d’autres pour une approche plus schématique. Pourtant, derrière cette diversité, une ossature commune se dessine : la plupart des rapports suivent la structure ESRS, articulée autour des standards généraux et des thématiques ESG. Ce socle commun permet une comparabilité à haut niveau, mais les divergences réapparaissent dès qu’on plonge dans les données granulaires, où les formats et contenus varient largement.
Matérialité : une convergence autour de quelques piliers
La notion de matérialité, pierre angulaire du CSRD, révèle des dynamiques intéressantes. Seules 10 % des entreprises considèrent l’ensemble des 10 standards thématiques comme matériels. La majorité se concentre sur 4 à 6 standards, avec une convergence marquée autour de trois piliers : le climat (E1), les salariés (S1), et la conduite des affaires (G1). Ces trois thématiques sont jugées matérielles par plus de 90 % des déclarants. À l’inverse, des sujets comme les microplastiques, les droits des peuples autochtones ou le bien-être animal restent marginalisés, souvent relégués à des mentions anecdotiques.
Cette hiérarchisation des enjeux reflète-t-elle une réelle analyse de double matérialité ou une forme de conformisme stratégique ? Le fait que certains sous-thèmes soient jugés matériels par moins de 5 % des entreprises suggère une vision encore très sectorielle et peu systémique des interdépendances entre enjeux environnementaux et sociaux.
Engagement des parties prenantes : un entre-soi persistant
Le processus de double matérialité repose sur l’engagement des parties prenantes. Or, l’analyse révèle une prédominance des acteurs internes et économiques : 97 % des entreprises consultent leurs salariés, 70 % leurs clients, 65 % leurs fournisseurs, et 60 % leurs investisseurs. En revanche, les ONG (33 %), les communautés locales (30 %), les syndicats (10 %) et le monde académique (15 %) restent largement en marge. Ce déséquilibre soulève une question cruciale : comment prétendre à une évaluation d’impact robuste sans intégrer les voix de celles et ceux qui subissent ces impacts ?
IROs et cartographie de la chaîne de valeur : une approche sectorielle encore cloisonnée
Les entreprises commencent à cartographier leurs impacts, risques et opportunités (IROs) sur l’ensemble de leur chaîne de valeur. Mais cette cartographie reste fortement influencée par le secteur d’activité. Les institutions financières se concentrent sur les entreprises qu’elles financent (downstream), tandis que les industriels privilégient leurs opérations internes et leurs fournisseurs (upstream). Cette sectorialisation, bien que logique, limite la capacité à appréhender les effets systémiques et les externalités croisées.
Disclosures spécifiques à l’entité : une invisibilité méthodologique
Enfin, un point méthodologique mérite l’attention : les disclosures spécifiques à l’entité – ces données propres à chaque entreprise, non prévues par les standards – sont rarement identifiées comme telles. Seules 30 % des entreprises les labellisent explicitement. Cette absence de transparence nuit à la comparabilité et à la traçabilité des informations, et affaiblit la promesse d’un reporting réellement adapté aux spécificités de chaque modèle économique.
Chapitre 2 – Introduction
2025 : l’année zéro du grand basculement
L’année 2025 marque une échéance réglementaire. Mais elle incarne aussi un tournant historique dans la manière dont les entreprises européennes rendent compte de leur empreinte sur le monde. Pour la première fois, le reporting de durabilité devient une obligation légale, encadrée par le CSRD et articulée autour des ESRS. Ce n’est ni une option, ni un exercice de communication : c’est une exigence normative, structurée, vérifiable, et potentiellement transformative.
Mais cette transition s’inscrit dans un contexte paradoxal : alors que la Commission européenne adopte en parallèle un « paquet de simplification » – l’Omnibus – pour alléger les charges administratives et renforcer l’attractivité économique, les entreprises se retrouvent face à une complexité croissante dans l’interprétation et la mise en œuvre des standards. Le rapport souligne cette tension entre ambition réglementaire et faisabilité opérationnelle, entre clarté normative et pluralité des pratiques.
Une première vague révélatrice
Les entreprises de la « vague 1 », celles qui publient leurs premiers rapports alignés sur les ESRS, deviennent les éclaireuses d’un nouveau paradigme. Leurs publications, bien que perfectibles, offrent une matière précieuse pour comprendre les dynamiques à l’œuvre : les zones de flou, les points de friction, mais aussi les innovations méthodologiques et les efforts de structuration. Ce rapport ne prétend pas à l’exhaustivité, mais il capte les signaux faibles et les tendances lourdes d’un système en train de se construire.
Il faut saluer ici l’intention du document : non pas juger, mais observer. Non pas prescrire, mais éclairer. Dans cette phase d’émergence, chaque rapport devient un laboratoire, chaque entreprise un cas d’école, et chaque ligne de reporting une tentative de concilier conformité, pertinence et sincérité.
Chapitre 3 – Scope
Une radiographie du terrain : qui sont les pionniers du reporting ESRS ?
Comprendre les pratiques de reporting, c’est aussi comprendre les contextes dans lesquels elles émergent. Il ne s’agit pas seulement de savoir ce qui est dit, mais par qui, où, et dans quelles conditions.
L’analyse couvre les rapports de durabilité publiés avant le 20 avril 2025, reflétant l’exercice 2024, par les entreprises soumises à la première vague du CSRD. Ce sont les grandes entités – souvent cotées, souvent transnationales – qui ont franchi les premiers le seuil de cette nouvelle exigence. Et leur diversité est grande : 656 rapports ont été collectés, couvrant 83 % d’entreprises non financières et 17 % d’institutions financières, avec une forte représentation du secteur manufacturier (38 %).
Une Europe en mouvement, mais inégalement mobilisée
La géographie des déclarants révèle une Europe à plusieurs vitesses. La France (16 %), l’Allemagne (13 %) et la Finlande (12 %) dominent le paysage, tandis que des pays comme l’Italie ou l’Espagne affichent une présence plus modeste. Hors UE, seuls quelques acteurs suisses et britanniques se sont engagés dans l’exercice, souvent de manière volontaire. Ce volontarisme, même en l’absence de transposition nationale du CSRD, témoigne d’un changement de paradigme : la durabilité devient un langage commun, au-delà des frontières réglementaires.
Des entreprises de grande taille, mais aux profils variés
Les entreprises analysées sont majoritairement grandes, comme l’exige le CSRD 1.0 : plus de 500 salariés, 25 M€ d’actifs ou 50 M€ de chiffre d’affaires. Mais derrière cette homogénéité apparente, les profils sont plus contrastés. Les entreprises non financières présentent une large gamme de tailles, avec des revenus moyens très variables selon les pays. Les institutions financières, quant à elles, affichent des bilans massifs, notamment en France, Espagne et Belgique.
Ce panorama montre que le premier cycle de reporting ESRS s’est déployé sur un terrain vaste, mais encore élitiste. Il faudra attendre les vagues suivantes pour voir émerger des pratiques plus représentatives des PME, des secteurs moins exposés, et des modèles économiques alternatifs.
Chapitre 4 – Cross-cutting standards
Structure et longueur : le récit éclaté de la durabilité
Les déclarations de durabilité varient de 25 à 440 pages, avec une moyenne de 115 pages. Ce n’est pas la taille qui fait la qualité, et l’analyse le confirme : ni le nombre de standards matériels, ni la taille de l’entreprise ne corrèlent significativement avec la longueur du rapport. Ce sont plutôt des facteurs culturels et sectoriels qui influencent la densité narrative : les pays du Sud (Espagne, Italie) produisent des rapports plus longs, tandis que les pays nordiques privilégient la concision.
Mais derrière cette diversité, la majorité des rapports suivent les standards ESRS, avec une articulation ESG relativement homogène. Cette convergence formelle est un signal fort : malgré les incertitudes, les entreprises s’approprient le cadre réglementaire.
Matérialité : une hiérarchie implicite des enjeux
La matérialité, censée refléter les impacts et risques les plus significatifs, dessine une hiérarchie implicite des préoccupations. Trois standards dominent : le climat (E1, 98 %), les salariés (S1, 99 %) et la conduite des affaires (G1, 93 %). Ce trio forme le socle du reporting ESRS, mais il révèle aussi une forme de standardisation des priorités.
D’autres thématiques, pourtant cruciales, restent marginales : l’eau (E3, 33 %), les communautés affectées (S3, 30 %), ou les droits des peuples autochtones (moins de 5 %). Cette sous-représentation interroge : est-elle le reflet d’une faible matérialité réelle, ou d’une difficulté à appréhender ces enjeux dans les méthodologies actuelles ?
Les entreprises non financières déclarent en moyenne 6 standards matériels, contre 5 pour les institutions financières. Les secteurs comme la construction ou l’énergie affichent jusqu’à 9 standards matériels, tandis que certains acteurs ne déclarent qu’un seul. Cette variabilité témoigne d’une appropriation encore tâtonnante du concept de double matérialité.
Parties prenantes : un dialogue encore trop fermé
Le processus de double matérialité repose sur l’engagement des parties prenantes. Or, l’analyse révèle une asymétrie préoccupante : 97 % des entreprises consultent leurs salariés, 70 % leurs clients, 65 % leurs fournisseurs, mais seulement 33 % les ONG, 30 % les communautés locales, et 11 % les syndicats.
Ce déséquilibre traduit une vision encore très « business-centric » du reporting. Les voix de la société civile, pourtant essentielles pour évaluer les impacts, restent marginalisées. Quelques entreprises pionnières intègrent des représentants communautaires ou académiques, mais elles restent l’exception.
PATs : une cartographie encore embryonnaire des politiques, actions et cibles
Les disclosures sur les PATs (Policies, Actions, Targets) sont souvent lacunaires, voire décoratives. Peu d’entreprises établissent un lien clair entre les politiques déclarées, les actions concrètes et les cibles mesurables. Pourtant, quelques cas exemplaires émergent : des rapports structurés en « one-pagers » par standard, avec des références croisées, des objectifs chiffrés, et une traçabilité des progrès.
Ce type de structuration, encore rare, pourrait devenir une norme de qualité dans les années à venir. Il permet de passer du déclaratif à l’opérationnel, et de rendre le reporting réellement utile pour les parties prenantes.
IROs et cartographie de la chaîne de valeur : vers une vision systémique ?
La cartographie des IROs (Impacts, Risks, Opportunities) commence à se structurer. Certaines entreprises identifient clairement les IROs par segment de chaîne de valeur, en distinguant les impacts positifs et négatifs, les risques et les opportunités. Elles intègrent aussi les parties prenantes externes (investisseurs, communautés, ONG), offrant une vision plus holistique.
Mais cette approche reste minoritaire. La majorité des rapports se contentent d’une cartographie partielle, souvent centrée sur les opérations internes ou les fournisseurs directs. Le défi des prochaines années sera d’élargir cette cartographie à l’ensemble du système socio-écologique dans lequel l’entreprise évolue.
Chapitre 5 – Standards thématiques : Environnement
Plans de transition climatique : entre ambition affichée et flou méthodologique
Le climat reste le pilier du reporting environnemental. 55 % des entreprises déclarent disposer d’un plan de transition pour la réduction de leurs émissions. Mais la réalité est plus nuancée : peu d’entre elles décrivent de manière complète les éléments attendus par l’IG4 (encore à l’état de projet). Les plans sont souvent déclaratifs, rarement opérationnels.
70 % des entreprises affichent des objectifs de réduction compatibles avec une trajectoire à +1,5°C pour leurs émissions de Scope 1 et 2. Mais seules 40 % étendent cette ambition au Scope 3, pourtant souvent majoritaire. Et un tiers n’a pas d’objectifs clairs à court terme. Ce décalage entre ambition climatique et couverture réelle des émissions traduit une forme de myopie stratégique.
60 % des objectifs climatiques sont validés par la SBTi, ce qui marque une avancée vers la crédibilité. Mais là encore, la validation externe reste partielle, notamment dans le secteur financier, où les approches sectorielles (comme la Net-Zero Banking Alliance) dominent.
5.2 Prix interne du carbone et biodiversité : les parents pauvres du reporting
L’adoption d’un prix interne du carbone reste marginale : seuls 20 % des déclarants y recourent, principalement dans les secteurs à forte intensité carbone (mines, énergie, transport). Dans les services, l’outil reste largement ignoré. Pourtant, il constitue un levier puissant pour internaliser les externalités et orienter les décisions d’investissement.
La biodiversité, quant à elle, est encore plus négligée. À peine 30 % des entreprises publient des indicateurs, avec une moyenne de 4 métriques par rapport. Les secteurs les plus concernés (construction, énergie, immobilier) sont les plus actifs, mais la majorité reste silencieuse. La France, la Suède et les Pays-Bas se distinguent par une meilleure couverture, tandis que l’Italie et l’Allemagne accusent un net retard.
Les indicateurs publiés sont souvent spécifiques à l’entité : nombre d’espèces menacées sur les sites, surface restaurée, engagements d’exclusion dans les portefeuilles financiers, ou encore exposition à des zones sensibles. Ces métriques, bien que pertinentes, manquent encore de standardisation, ce qui limite leur comparabilité.
Effets financiers des risques climatiques : vers une quantification des impacts
Quelques entreprises pionnières commencent à quantifier les effets financiers des risques climatiques. Elles cartographient leurs actifs critiques (entrepôts, data centers, infrastructures) face aux aléas climatiques (inondations, canicules, stress hydrique), et estiment les pertes potentielles à l’horizon 2050. Ces analyses sont souvent accompagnées de visualisations géographiques et de programmes de prévention.
Mais ces pratiques restent rares. La majorité des rapports se contentent d’une description narrative des risques, sans chiffrage ni lien clair avec les états financiers. Or, sans quantification, le risque climatique reste une abstraction.
Chapitre 6 – Standards thématiques : Social
Salaires adéquats : une conformité sans granularité
93 % des entreprises déclarent verser des salaires adéquats à leurs employés dans l’EEE. Ce chiffre, en apparence rassurant, cache une réalité plus floue : peu d’entreprises distinguent entre les zones EEE et non-EEE, et encore moins contextualisent leurs déclarations. Le respect des seuils légaux ne suffit pas à garantir une rémunération juste, surtout dans les chaînes de valeur mondialisées. Le reporting reste ici largement déclaratif, sans indicateurs de pouvoir d’achat, de seuil de pauvreté ou de conditions de vie.
Droits humains : une transparence en trompe-l’œil
Les incidents graves liés aux droits humains sont rarement rapportés. 78 % des entreprises déclarent ce point, mais seulement 5 % mentionnent un ou plusieurs cas. Même constat pour les discriminations : 81 % des entreprises les évoquent, mais avec une variabilité extrême dans les chiffres. Dans les chaînes de valeur, la situation est encore plus opaque : un tiers des entreprises abordent le sujet, mais seulement 10 % rapportent des incidents.
Ce silence statistique est-il le signe d’une réelle absence de violations, ou d’une incapacité à les détecter ? Le rapport évoque des cas de discrimination, de harcèlement, et d’abus, mais sans granularité ni analyse des mécanismes de prévention. Le reporting sur les droits humains reste l’un des plus fragiles, malgré son importance éthique et réglementaire.
Salariés : vers une intégration des politiques, actions et résultats
Certaines entreprises commencent à relier leurs politiques RH à des actions concrètes et à des indicateurs de performance. Des cas exemplaires montrent une articulation claire entre politiques de santé et sécurité, programmes internes, indicateurs (accidents, jours perdus), et cibles chiffrées. De même, les politiques de rémunération intègrent des objectifs de réduction des écarts de salaire entre genres, avec des méthodologies transparentes et des ratios de rémunération publiés. Ces pratiques restent minoritaires, mais elles dessinent une voie vers un reporting social plus mature, fondé sur la cohérence entre intentions, moyens et résultats.
Travailleurs de la chaîne de valeur : de la politique à l’action
Le reporting sur les travailleurs indirects commence à se structurer. Certaines entreprises intègrent les principes internationaux (ONU, OIT, OCDE) dans leurs politiques fournisseurs, avec des mécanismes de due diligence, des audits, et des canaux de plainte accessibles. Elles segmentent leurs fournisseurs selon le risque, et adaptent leurs exigences en conséquence. Mais là encore, la majorité reste en retrait. Le lien entre politique et mise en œuvre est souvent ténu, et les mécanismes de suivi peu détaillés. Le défi est de passer d’une approche déclarative à une gouvernance réelle des droits humains dans les chaînes de valeur.
Communautés affectées : vers une reconnaissance des impacts locaux
Un nombre croissant d’entreprises commence à considérer les communautés comme parties prenantes matérielles. Elles publient des indicateurs spécifiques : nombre de personnes touchées par des programmes, accès aux services financiers, investissements communautaires, usage des mécanismes de plainte, évaluations d’impact social. Ces disclosures, encore volontaires, traduisent une volonté de mesurer la valeur sociale créée. Mais leur efficacité dépendra de leur intégration dans les processus de décision, et de leur capacité à refléter les réalités vécues par les communautés.
Consommateurs et utilisateurs finaux : l’émergence d’un récit de responsabilité
Les entreprises à forte exposition B2C commencent à structurer leur reporting sur les impacts consommateurs. Elles publient des indicateurs sur la satisfaction, la consommation responsable, l’inclusion des produits, l’engagement digital, et les mécanismes de plainte. Certaines vont plus loin, en intégrant des initiatives de marque liées à la santé mentale, à l’inclusion sociale ou à la littératie financière. Ce reporting, encore très lié à la réputation, pourrait évoluer vers une véritable évaluation des impacts sociaux des produits et services. Il reste à en renforcer la robustesse méthodologique et la comparabilité.
Chapitre 7 – Annexe
Limites et précautions : un regard lucide sur les biais de l’analyse
Le rapport assume ses limites. Une partie des analyses repose sur l’utilisation de l’intelligence artificielle générative (GenAI), dont les résultats ont été systématiquement vérifiés sur un échantillon de 50 rapports. Malgré cette validation, le risque d’erreurs – ou « hallucinations » – demeure. Les statistiques présentées doivent donc être lues comme des tendances de marché, et non comme des vérités absolues à l’échelle individuelle.
De plus, le périmètre de collecte des rapports s’arrête au 20 avril 2025. Certains documents publiés après cette date n’ont pas été intégrés, ce qui peut biaiser la représentativité. Enfin, le rapport ne prétend pas à l’exhaustivité : il ne couvre que les entreprises soumises à la première vague du CSRD, et ne s’applique pas aux PME non cotées.
Méthodologie : une ingénierie d’analyse à grande échelle
La méthodologie déployée est ambitieuse. 656 rapports ont été collectés via des sources multiples (fournisseurs de données, alertes, recherches avancées). Un moteur GenAI sur mesure a été entraîné pour analyser ces documents selon 13 questions préalablement sélectionnées. Seules 11 ont passé le seuil de qualité défini par la méthode AQL (Acceptable Quality Level), garantissant moins de cinq erreurs par question.
Chaque question a été testée sur un échantillon représentatif, avec des réponses manuelles servant de référence. Les prompts ont été affinés jusqu’à atteindre une précision acceptable, puis déployés à l’échelle du corpus. Cette approche hybride – entre automatisation et vérification humaine – permet de concilier scalabilité et fiabilité.
Glossaire : les fondations conceptuelles du reporting ESRS
Conclusion générale – Un système en construction, entre rigueur normative et pluralité des pratiques
Le système de reporting est en pleine éclosion. L’entrée en vigueur du CSRD et des ESRS marque une rupture : la durabilité devient un objet de reporting structuré, normé, et potentiellement transformateur. Mais cette ambition se heurte à la réalité des pratiques : hétérogènes, parfois lacunaires, souvent encore trop déclaratives.
Les entreprises de la « vague 1 » ont ouvert la voie, avec courage mais aussi prudence. Elles ont tenté de traduire des standards complexes en récits compréhensibles, de relier des politiques à des actions, et de cartographier leurs impacts dans un monde incertain. Certaines ont innové, d’autres ont tâtonné. Toutes ont contribué à faire émerger un langage commun de la durabilité.
Le défi des prochaines années sera double : approfondir la qualité des disclosures, et élargir le périmètre des acteurs engagés. Il faudra renforcer la comparabilité, intégrer les voix de la société civile, et développer des méthodologies robustes pour les enjeux encore sous-traités (biodiversité, droits humains, impacts communautaires). Il faudra aussi éviter que le reporting ne devienne un exercice de conformité vide de sens.
La ressource
State of play 2025 par l’EFRAG